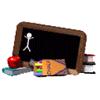L’histoire
retient par tradition la date de 1839 pour la première
photographie. L’image, très contrastée, représente un
boulevard du Temple aussi vide qu’une plaine du Grütli un
jour de non-fête nationale. Si l’artère paraît peu fréquentée,
c’est que la machine de Louis Jacques Mandé Daguerre nécessite
des temps de pause fort longs. Elle ne fixe donc rien des
mouvements rapides des calèches et des citoyens. Qu’importe,
l’invention connaît une fortune qui franchit aisément les
barricades de la Commune. Et, à en croire l’exposition
L’Afrique par elle-même: 100 ans de photographies visible
depuis hier à l’ONU, débarque presque aussitôt sur le
continent noir.
L’histoire
retient par tradition la date de 1839 pour la première
photographie. L’image, très contrastée, représente un
boulevard du Temple aussi vide qu’une plaine du Grütli un
jour de non-fête nationale. Si l’artère paraît peu fréquentée,
c’est que la machine de Louis Jacques Mandé Daguerre nécessite
des temps de pause fort longs. Elle ne fixe donc rien des
mouvements rapides des calèches et des citoyens. Qu’importe,
l’invention connaît une fortune qui franchit aisément les
barricades de la Commune. Et, à en croire l’exposition
L’Afrique par elle-même: 100 ans de photographies visible
depuis hier à l’ONU, débarque presque aussitôt sur le
continent noir.
Autre Afrique
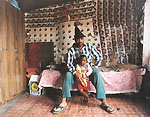 "Les premiers appareils sont arrivés
avec des photographes occidentaux ou des militaires. Ces
voyageurs montaient leur studio de village en village et
formaient des apprentis", explique Pascal Martin Saint Léon.
Architecte de formation, ce Français a cofondé La Revue Noire
il y a dix ans "pour présenter un autre aspect de
l’Afrique. Quelque chose de moins paillotes et cocotiers.
L’idée était de montrer à travers la culture le dynamisme
d’un continent trop souvent perçu comme allant à la dérive".
"Les premiers appareils sont arrivés
avec des photographes occidentaux ou des militaires. Ces
voyageurs montaient leur studio de village en village et
formaient des apprentis", explique Pascal Martin Saint Léon.
Architecte de formation, ce Français a cofondé La Revue Noire
il y a dix ans "pour présenter un autre aspect de
l’Afrique. Quelque chose de moins paillotes et cocotiers.
L’idée était de montrer à travers la culture le dynamisme
d’un continent trop souvent perçu comme allant à la dérive".
Il allait donc de soi pour les représentants onusiens de la
francophonie de demander à l’éditeur une exposition sur la
photographie africaine, l’organisation affichant cette année
"le dialogue entre les cultures" à son calendrier.
Montée avec Sandra Coulibaly Leroy, directrice adjointe de la
francophonie au Palais des Nations, l’accrochage présente 94
images originales ou retirées, toutes prises en Afrique par des
Africains.
Galerie de
portraits
 Pas de savane ni de grandes étendues désertiques
au programme. L’essentiel des tirages exposés montre des
visages. "Pendant la période de la colonisation il était
formellement interdit de prendre des images en extérieur. Par
raison de sécurité sans doute", précise Pascal Martin
Saint Léon dont la voix résonne sous l’immense plafond de la
salle des Pas perdus.
Pas de savane ni de grandes étendues désertiques
au programme. L’essentiel des tirages exposés montre des
visages. "Pendant la période de la colonisation il était
formellement interdit de prendre des images en extérieur. Par
raison de sécurité sans doute", précise Pascal Martin
Saint Léon dont la voix résonne sous l’immense plafond de la
salle des Pas perdus.
"Du coup, les photographes se sont repliés dans leur
studio pour travailler essentiellement le portrait." Le spécialiste
pointe l’image d’une naïade fixé dans les années 50 par
Mama Casset, le maître sénégalais du genre. "Il a créé
le stéréotype de l’attitude féminine: lèvre entrouverte,
doigts légèrement écartés, sans oublier les yeux qui doivent
laisser voir leur blanc."
Habits du
dimanche
 Les tenues mis à part, on pose en
Afrique comme en Occident. Des deux côtés de la Méditerranée
les modèles portent beau pour leur séance photo. L’image
n’est-elle pas censée les immortaliser pour l’éternité?
Mais si en Afrique du Sud les clients s’endimanchent comme
pour le Grand Prix d’Epsomavec guêtres et nœud papillonles
femmes de Saint-Louis, elles, choisissent des atours plus
typiques.
Les tenues mis à part, on pose en
Afrique comme en Occident. Des deux côtés de la Méditerranée
les modèles portent beau pour leur séance photo. L’image
n’est-elle pas censée les immortaliser pour l’éternité?
Mais si en Afrique du Sud les clients s’endimanchent comme
pour le Grand Prix d’Epsomavec guêtres et nœud papillonles
femmes de Saint-Louis, elles, choisissent des atours plus
typiques.
"Ce cliché a été miraculeusement conservé", précise
le commissaire de l’exposition devant une jeune fille saisie
vers 1920 dans un intérieur à fleurs. Le nom du portraitiste
n’est pas connu. "Il n’est pas rare qu’à la mort du
photographe, la famille jette toutes ses archives. Celui-ci a eu
plus de chance. C’est l’un de ses confrères qui a tout gardé."
Manière de dire qu’en Afrique la prise de conscience d’un
patrimoine iconographique reste récente. Elle s’amplifie
depuis qu’à Bamako s’organise une biennale de la photo. La
manifestation, dont la 4e édition vient de s’ouvrir, a déjà
révélé quelques talents. Dont celui de Malick Sidibé qui
n’est pas à proprement parler le premier venu.
Agé de 64 ans, le photographe, à qui le Centre d’art
contemporain de Genève a consacré une exposition en 2000, doit
sa célébrité à son Bamako by night, daté des années 60.
L’appareil en bandoulière, Sidibé traîne à l’époque
dans les boîtes de nuit. Et part brosser le portrait d’une
jeunesse qui découvre, en même temps que l’indépendance, la
pop anglaise et la mode des sixties.
Folle nudité
Si les souvenirs de night-club
demeurent, aujourd’hui encore, ils sont la principale source
de revenu des photographes du continent, "malheureusement
moins nombreux qu’en 1900 à exercer le métier", se désole
Pascal Martin Saint Léon. "La presse manquant souvent de
moyens et le matériel coûtant cher, la plupart se replient sur
les photos d’identités." Quelques-uns se risquent
pourtant au reportage. Des histoires que La Revue Noire
s’efforce de publier. Comme ces Fous d’Abidjan que Dorris
Haron Kasco a suivi dans les rues. Images délirantes d’hommes
et de femmes qui se promènent complètement nus au milieu des
voitures. Et dont le visiteur se demande bien ce qu’un Sélassié
léonin, exposé un peu plus loin, peut en penser.